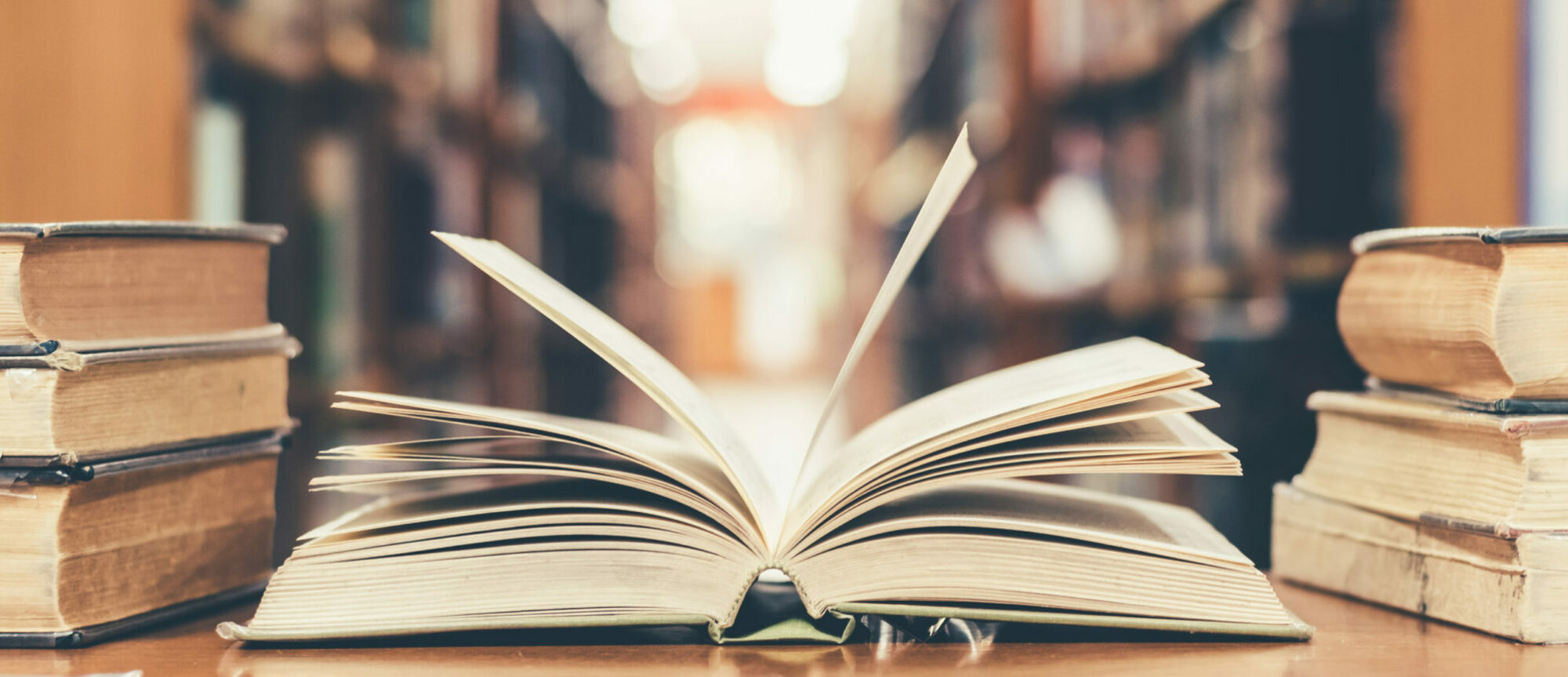Propos recueillis par Nicolas Vidal. Lire l’entretien sur le site de Putsch.
Derrière les ministres qui défilent rue de Grenelle, une autre Éducation nationale, souterraine et dogmatique, semble tirer les ficelles. Romain Vignest, professeur de lettres classiques et président de l’Association des professeurs de lettres, dénonce dans un entretien sans filtre l’existence d’une “Éducation nationale profonde” plus loyale à une doxa idéologique qu’à la République. Formateurs, syndicats, rectorats : il décrit un système verrouillé par des “missionnaires zélés” au service non des élèves, mais des intérêts de la haute finance mondialisée. À l’opposé du prêt-à-penser pédagogique, il appelle à une restauration radicale de l’instruction, ancrée dans les humanités. Un plaidoyer pour un retour à l’intelligence classique contre le règne du slogan et de la compétence jetable.
Vous évoquez une “Éducation nationale profonde”, imperméable aux directives ministérielles. S’agit-il selon vous d’un État dans l’État ? Et à qui profite ce blocage structurel ?
Ce que j’appelle l’Éducation nationale profonde a été imperméable, et même s’est opposée aux directives ministérielles quand celles-ci sont allées à l’encontre de ses conceptions et elle y contreviendrait encore le cas échéant. Mais soyons clairs : depuis Xavier Darcos, cela ne s’est pas produit. Pour répondre à votre question, je ne parlerais pas d’État dans l’État dans la mesure où ceux qui la composent (formateurs des INSPÉ, inspecteurs régionaux, fonctionnaires rectoraux…) sont liés moins par une structure que par une doxa qu’ils croient progressiste et par leur commune conviction qu’ils en sont les défenseurs. Disons qu’en missionnaires zélés ils servent Dieu avant César, mais sans s’interroger au fond sur le dieu qu’ils servent et auquel profite leur zèle. Car les officines, institutionnelles ou privées, où, sous couvert de science, s’est forgée cette doxa n’ont rien à proprement parler de philanthropique : OCDE, Commission européenne, Trilatérale, European Round Table, Le Siècle… En 1998, un petit livre intitulée Tableau noir avait reproduit les textes qu’elles consacraient à l’éducation et dans lesquels, comme ils n’étaient pas destinés au grand public, s’étale leur cynisme. Elles servent les intérêts de la haute finance globalisée, non ceux des élèves ni ceux des nations, et c’est selon ses intérêts politiques qu’elles visent à reconfigurer l’appareil éducatif.
Vous dénoncez une idéologie dominante au sein de l’institution, que vous qualifiez de “refus d’instruire”. Quelles sont, selon vous, ses origines intellectuelles et ses relais concrets dans les rectorats, les INSPE ou les syndicats ?
Cette idéologie, c’est celle des sciences de l’éducation, leur présupposé épistémologique : elles se substituent aux disciplines parce que la pédagogie est indépendante des contenus et qu’eux-mêmes sont secondaires par rapport aux compétences qu’il s’agit de développer chez l’élève. En quoi elles ne sont que la déclinaison éducative de l’économie politique, c’est-à-dire d’une science des nations supposée conférer un fondement rationnel et indiscutable au décisions des princes. Elles flattent leurs séides de l’illusion d’être les hussards de la raison, quand ils ne sont que les godillots de la finance. Il n’est pas anodin à cet égard que les IUFM, mis en place par Jospin en 1990 et dont les INSPÉ ne sont que le dernier avatar en date, soient calqués sur le modèle inventé par le capitalisme états-unien : ils permettent de retirer à l’Université la formation des enseignants, donc de dissocier l’enseignement scolaire de la transmission des savoirs. Car celle-ci n’est pas l’objet de « l’École du capitalisme intégral », comme l’appelle Jean-Claude Michéa dans L’Enseignement de l’ignorance : le grec ancien, l’analyse logique et la dissertation ne représentent absolument aucun intérêt pour ses desseins et pourraient même leur être nuisibles. J’invite vos lecteurs à consulter, entre autres, le rapport de la Commission européenne du 24 mai 1991 : à la rigueur, un enseignement substantiel peut avoir, dans une certaine mesure, sa place dans les pôles d’excellence qui forment l’élite, mais il ne convient ni pour la main d’œuvre des firmes transnationales, qui doit être docile, flexible et satisfaite, ni a fortiori pour la masse inemployée ou ubérisée, qu’il faut maintenir de bonne humeur et dans l’incapacité morale et intellectuelle de se révolter. En tout état de cause, tous, y compris l’élite, doivent être coupés de tout sentiment d’appartenance historique, de toute conscience patrimoniale : la société liquide, comme l’appelle Zygmunt Bauman, veut une table rase. Aussi est-ce sciemment qu’ont été importées des États-Unis et recommandées comme scientifiquement correctes par Philippe Meirieu les méthodes qui avaient conduit l’école américaine à un désastre déjà avéré et notoire. Mais, Liliane Lurçat l’a abondamment illustré, il fallait à ce cynisme libéral ses idiots utiles, ses naïfs libertaires, pour qui la tradition est oppressive par principe : ce fut le rôle de Bourdieu de fournir le prétexte idéologique à l’abolition des humanités, considérées comme un « capital symbolique ». Il faut lire les instructions officielles de 1972, qui déjà se ressentent de ses analyses et à partir desquelles la culture littéraire cesse d’être le pivot de l’enseignement du français – quitte à lui préférer des affiches publicitaires comme support pour apprendre à lire. À partir de 1988, après la parenthèse Chevènement, la gauche politique et syndicale désormais ralliée au libéralisme et à la « construction européenne » put, au nom de l’anti-capitalisme lui-même, lever l’obstacle majeur qu’elles représentaient pour l’extension à l’école du règne de la marchandise. Elle put dans cette œuvre compter notamment sur le soutien sans faille du SGEN-CFDT, qui fournit d’ailleurs un bon nombre de ses formateurs aux IUFM. Quant à la droite, vous connaissez peut-être la formule de Russell Jacoby à propos de sa « fraction incohérente », qui « vénère le marché tout en maudissant la culture qu’il engendre »…
Vous critiquez vertement les programmes d’actions dites citoyennes, inclusives ou de prévention. Faut-il selon vous les supprimer purement et simplement ou en repenser le périmètre pour éviter la saturation de l’école par le militantisme ?
Laissons de côté les actions de prévention strictement pratiques, qui ne sont d’ailleurs pas les plus fréquentes, telles que les formations aux gestes de premier secours ou aux conduites à adopter en cas de danger – lesquelles pourraient fort bien être assurées par les professeurs d’EPS ou les infirmières scolaires. Le reste pallie les carences de l’enseignement, notamment littéraire, mais dans une perspective tout à fait inverse, dogmatique au lieu d’être euristique, au point que ces carences paraissent voulues en vue de cette substitution. On en a dépossédé le cours de français, à la fois parce qu’une certaine inculture a fait dire à certains imbéciles qu’il fallait déboulonner les auteurs (au sens étymologique du mot : l’auctor est celui qui nous grandit) ; d’autre part parce que l’approche des textes est devenue techniciste, évacuant leur enjeu humain, là encore par souci démocratique de gommer le déficit de références des moins bien lotis – qui ainsi ne les acquerront jamais. Or l’étude de la chose humaine, c’est précisément l’objet de la littérature, et sous tous les angles : affectif, relationnel, intellectuel, métaphysique, politique etc. Homo sum. Nil humani a me alienum puto, écrit Térence dans sa comédie Heautontimoroumenos (« Le Bourreau de lui-même »). Tous les sujets qu’abordent les actions et interventions dont nous parlons, rapport à l’autre, au corps, à la nature, à la collectivité etc. la littérature permet de les traiter, en situation et en les problématisant, en prenant du recul, grâce à la distance des siècles et à la variété des mœurs, et par-dessus le marché, dit Descartes, sous la forme d’« une conversation avec les meilleurs esprits des siècles passés ». Allons plus loin. C’est en étudiant le vocabulaire qu’on apprend à nommer et à cerner qui sa mélancolie, qui son dépit, qui son enthousiasme ; c’est en apprenant la syntaxe qu’on apprend à articuler les idées comme les sentiments ; c’est par la pratique d’une langue non vernaculaire, le latin, qu’on s’extrait et qu’on s’émancipe de ce que Mallarmé appelle « les mots de la tribu » et Barthes « le fascisme de la langue ». Voilà l’humanisme au sens du XVIe siècle, qu’Érasme dans la Querela pacis (La Complainte de la paix) résume très bien : « Les bonnes lettres rendent les hommes humains. » C’est en cours de français et de langues anciennes qu’on apprend, lentement et sûrement, à se penser, à se penser au monde, à se penser parmi les autres, qu’on devient homme, indépendamment de tout objectif politique ou économique. C’est ainsi qu’on a formé l’humanité des enfants depuis l’Antiquité, par la fréquentation précoce, patiente et assidue d’Homère, Sophocle, Térence, Cicéron, Sénèque, Rabelais, Montaigne, Corneille, La Fontaine, Molière, Racine, Voltaire, Rousseau, Chateaubriand, Hugo, Balzac, Flaubert, Baudelaire, Mauriac… Qu’on prenne en passant la mesure de la rupture anthropologique que nous connaissons depuis trente ans qu’on a décidé de faire autrement et qu’on préfère aux humanités l’éducation aux compétences psychosociales, une humanité prête à l’emploi, le kit du savoir-être conçu et fourni par McKinsey. Or qu’on s’interroge : comment appelle-t-on une société où l’on préfère traiter de la relation entre patient et médecin au moyen des supports conçus par l’industrie pharmaceutique plutôt qu’avec Molière et Jules Romains ?
Vous accusez certaines associations intervenant dans les établissements d’être des “parasites” et des “militants”. Quels critères devraient encadrer selon vous leur présence dans les écoles, et qui devrait avoir autorité pour la valider ou la refuser ?
Notez que le problème n’est pas propre à l’Éducation nationale : la sous-traitance par l’État de son action a suscité, encore qu’il s’en trouve de très compétentes et très bien inspirées, tout un éco-système malsain d’associations qui sont davantage mues par le profit qu’elles en tire et plus perméables aux influences idéologiques ou tout simplement à l’esprit du temps qu’elles ne sont animées par le service de l’État, dont elle ne font pas partie. C’est cela aussi la sape de l’esprit républicain. Aussi suis-je tout bonnement partisan de leur totale éviction. À vrai dire, même l’intervention d’agents issus d’autres corps de l’État que l’Éducation nationale et l’Enseignement supérieur, tels que des policiers par exemple, devrait être exclue, car « l’institution des enfants », comme dit Montaigne, doit être préservée de toute interférence avec quelque autre dessein public, si légitime soit-il. Souvenez-vous de la lettre de Jules Ferry aux instituteurs : « Vous ne toucherez jamais avec trop de scrupule à cette chose sacrée qu’est la conscience de l’enfant. »
Vous évoquez une caste convaincue de “détenir le Vrai et le Bien”. Peut-on encore débattre pédagogie, ou tout désaccord est-il automatiquement rangé dans la catégorie du “réactionnaire” ou du “rétrograde” ?
Il en est là encore de l’Éducation nationale comme du reste. Le débat est de nos jours chose presque impossible, l’anathème a remplacé la réfutation. C’est peut-être d’ailleurs une conséquence de ce qu’on ne maîtrise plus l’art du discours ! L’air du temps est marqué par cette prétention des modernes que fustigeait Baudelaire, par le scientisme, qui veut faire de l’enseignement une science au lieu d’un art, disqualifiant tout empirisme, et par une espèce de progressisme niais, pour lequel le neuf est bon et l’ancien mauvais par nature. Pédagogiquement, il ne faut donc jamais faire comme avant, il faut surtout proscrire l’empirisme ; quant aux contenus, pourquoi étudier un passé dont on n’a rien à apprendre, sinon de ses erreurs ? L’idée scientiste de l’homme nouveau, qui doit se libérer du passé, est aujourd’hui plus que jamais d’actualité. Or cette idée confine à l’inversion accusatoire (autre caractéristique de notre époque), car c’est au contraire le détour par le passé qui libère, qui permet de relativiser et de subvertir le présent, de même que le surplomb des génies ridiculise les pontes du jour. Souvenons-nous de la leçon d’Hannah Arendt : « C’est justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que l’éducation doit être conservatrice. » Mais peut-être est-ce justement pourquoi on n’a pas laissé « au sommet des études ces grands livres latins et grecs », qu’« emplissent », dit Hugo, « les vents immenses de l’esprit » : les « grandeurs d’établissement », comme les appelle Pascal, n’aiment pas les tempêtes…
Vous appelez de vos vœux un “Alcide” pour sauver l’institution. Faut-il comprendre que vous plaidez pour une refondation autoritaire et radicale de l’Éducation nationale ? Et si oui, par quels moyens concrets l’engager ?
C’est évidemment une allusion aux écuries d’Augias, lesquelles n’ayant pas été nettoyées depuis trente ans étaient devenues inaccessibles. Aussi ne s’agit-il pas tant d’une refondation que d’une restauration. Il s’agit de rendre l’Éducation nationale à son fonctionnement normal et républicain, de mettre fin aux altérations, à la dénaturation dont elle est victime depuis cinquante ans, de la débarrasser de tout ce et de tous ceux qui, en marginalisant, entravant ou dénaturant sa mission, parasitent le travail du professeur, dont le métier et le rôle doivent être remis au centre de l’Institution. Aussi faudra-t-il purement et simplement supprimer certaines instances (Conseil Supérieur de l’Éducation, Conseil Supérieur des Programmes) et surtout les INSPÉ, pour rendre à l’Université la formation des professeurs et la préparation d’un CAPES redevenu disciplinaire. Mais d’autres, comme l’Inspection générale, devront être rétablies dans leur fonctionnement et leurs prérogatives, ou voir, comme la DGESCo, leur périmètre d’action redéfini, moyennant le renouvellement de leurs personnels, qui devraient être exclusivement issus des corps professoraux et choisis pour leur excellence disciplinaire. Une telle involution exigera assurément de l’autorité, mais celle-ci devra puiser sa légitimité auprès du peuple français. Un référendum sur le projet de loi qui porterait restauration de son instruction pourrait être l’Alphée ou le Pénée, le fleuve qui décrassera l’École. Après quoi il faudra, comme Héraclès, refermer le mur, et laisser élèves et professeurs étudier dans la sérénité.